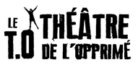Les petites sœurs n’ont pas le droit de souffrir de Héloïse Marty le jeudi 16 octobre 2025 à 12h au Théâtre de l’Opprimé
Mise en maquette de Charlotte Dautrey du Studio JLMB.
Résumé :
Dans les années 1970, trois sœurs vivent isolées dans une forêt au pied d’un plateau calcaire. En haut, un élevage intensif domine ; en bas, une rivière rouge devient le théâtre de morts étranges : un chien, un faon, un loup, puis un ouvrier succombent mystérieusement. Face au déni qui les entoure, les sœurs s’engagent malgré elles dans une lutte pour la vérité. Aux côtés d’une vétérinaire et de la fille du maire, elles tissent des liens inattendus dans une quête d’empathie et de compréhension. Cette fable écologique interroge les hiérarchies de l’existence et explore nos relations humaines face à l’incommensurable.
Note d’intention :
La mise en maquette de Les petites sœurs n’ont pas le droit de souffrir, texte d’Héloïse Marty, est l’occasion pour moi d’expérimenter pour la première fois la mise en scène, en complément de mon parcours de comédienne au sein du Studio JLMB. C’est une découverte, une tentative sincère de donner corps à un texte qui m’a immédiatement bouleversée par sa poésie.
Ce projet, mené avec les comédiennes présentes au plateau, est un geste collectif. Le texte s’offre à nous comme une plongée dans un imaginaire riche, qui laisse une grande place à l’interprétation, à l’émotion, à l’intime. C’est aussi un écho à notre propre travail de création et à nos amitiés.
Les petites sœurs n’ont pas le droit de souffrir est une fable qui raconte la vie de femmes mises à l’écart, blessées, mais debout. Un imaginaire riche est déployé, peuplé de figures singulières, parfois fantastiques. Il y a là une forme de chasse aux sorcières contemporaine : une société qui rejette, mutile ou détruit les femmes qui vivent, pensent, ou aiment autrement. Une violence sourde, imposée par les structures patriarcales et capitalistes, qui s’exerce sur les corps féminins avec une cruauté banalisée.
Au cœur de ce texte, il y a la relation entre ces femmes. Ce lien, complexe, parfois conflictuel, mais toujours viscéral, nous a profondément émus. Il ne s’agit pas de psychologie ni de rivalité : c’est une sororité brute, sans fard, traversée par l’amour, la colère, la tendresse, le sacrifice. Ce sont des femmes qui ne savent pas faire autrement que de s’aimer fort, de se confronter, de se soutenir – même maladroitement. Nous avons voulu que ce rapport s’incarne dans les corps, dans les gestes, dans les silences autant que dans les mots.
Notre travail s’inscrit dans cette tension, qui se tisse au milieu de la vie quotidienne, pour faire entendre l’invisible. L’ambition est de ne pas tomber dans la démonstration. La mise en scène reste volontairement épurée, intemporelle, presque post-apocalyptique, pour faire de cette clède – maison humide et fragile – un refuge universel. C’est un lieu de survie, mais aussi d’amour, de cris, de tendresse. Un espace où la sororité ne se joue pas dans la douceur, mais dans l’affrontement nécessaire, dans le lien viscéral. La lumière est notre alliée pour faire vivre en opposition la chaleur de ce lieu de réconfort et la froideur du monde extérieur et de tous ces dangers.
Le rythme du récit s’est imposé à nous comme un flot continu. C’est un mouvement ininterrompu, tendu vers une fin dont on pressent la violence sans jamais vraiment pouvoir
l’arrêter. Nous avons choisi de travailler cette urgence par un plateau relativement nu, où l’espace évolue au fil des scènes, à travers la lumière, les déplacements, la musique. Le rythme devient alors celui d’une fuite en avant : un rythme organique, sans pauses, presque respiratoire. Si le militantisme est d’abord suggéré, métaphorique, nous avons souhaité penser la fin comme un tournant : un acte de désobéissance civile, une mise en action devenue inévitable.
Cette version éphémère de notre travail est avant tout un souhait de mettre en avant la langue singulière de ce texte. Nous avons à cœur de transporter les spectateurs.ices dans sa poésie pour servir son propos feministe et écologique sans jamais être didactique ou moralisateur.